Cette semaine, France Culture a diffusé une suite d'émissions sur la Bhagavad Gita, que l'on peut réécouter à l'adresse suivante :
https://www.franceculture.fr/emissions/series/la-bhagavadgita-0
Si le lien était devenu obsolète, allez sur le site de franceculture.fr,
puis cliquez sur : Savoirs,
puis sur : Les chemins de la philosophie,
puis sur : La Bhagavad Gītā.
_____________________________________________________________
Voici une présentation de chacune de ces émissions.
PREMIER ÉPISODE : FAUT-IL RENONCER POUR MIEUX AVANCER ?
Aucune œuvre indienne n’a été plus lue et plus traduite dans le monde que la Bhagavad-Gita. Cet épisode, le plus célèbre du Mahabharata, met en scène le guerrier Arjuna aux prises avec un dilemme moral. Krishna, son guide, va le mener sur la voie du renoncement et de l'ascèse.
La Bhagavad-Gita, ou Chant du Bienheureux est un poème mystique et philosophique rédigé en sanscrit aux alentours du IIIe siècle avant J.-C. Il fut élevé au rang de texte sacré par les Hindous. Épisode le plus célèbre de l’épopée du Mahabharata, il rapporte l’enseignement délivré par le dieu Krishna au guerrier Arjuna.
 Arjuna de la lignée des Pandava, s'apprête à affronter ses cousins de la lignée des Kaurava, lorsque, tel Achille au début de L'Illiade qui est pris d'une colère noire, il décide lui aussi de se retirer du combat. À la différence d'Achille, il n'est pas en colère, mais il doute, il doute tellement qu'il est pris de vertige, face à un dilemme moral qui signe l'entrée dans une nouvelle ère de questionnement : Qui doit-il écouter ? Son devoir de guerrier qui lui prescrit de tuer tous les membres de sa famille ? Ou bien le respect de sa parenté commune doit-il le conduire à renoncer à son honneur militaire ?
Arjuna de la lignée des Pandava, s'apprête à affronter ses cousins de la lignée des Kaurava, lorsque, tel Achille au début de L'Illiade qui est pris d'une colère noire, il décide lui aussi de se retirer du combat. À la différence d'Achille, il n'est pas en colère, mais il doute, il doute tellement qu'il est pris de vertige, face à un dilemme moral qui signe l'entrée dans une nouvelle ère de questionnement : Qui doit-il écouter ? Son devoir de guerrier qui lui prescrit de tuer tous les membres de sa famille ? Ou bien le respect de sa parenté commune doit-il le conduire à renoncer à son honneur militaire ?
Dans les deux cas, il devra sacrifier, ou son honneur ou sa famille, et renoncer, soit à son honneur, soit à sa famille.
L’invité du jour : Marc Ballanfat, professeur de philosophie honoraire en Classes Préparatoires, traducteur de textes sanscrits et spécialiste des philosophies indiennes
Une immense épopée : « La Bhagavad-Gita fait partie d'une immense épopée qu'on appelle le Mahabharata qui a été composée sur quatre ou cinq siècles. Pendant des siècles, des gens ont composé et ajouté des histoires qui se sont enchâssées les unes dans les autres. » Marc Ballanfat
La voie du renoncement : « Krishna va proposer à Arjuna une troisième voie possible : celle du renoncement. Il faut renoncer à investir des désirs dans les actes. Tant qu'on recherche une satisfaction, on ne peut pas être dans le renoncement. Krishna va lui montrer que dans une guerre on ne peut pas poursuivre une satisfaction, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'honneur, ni de richesse à obtenir d'une guerre. Une guerre c'est un sacrifice un point c'est tout. » Marc Ballanfat
Annoncer quelque chose en retour : « Il est dommage qu'aujourd'hui le mot renoncer soit utilisé uniquement dans un sens négatif. Jusqu'au XIIe siècle, renoncer signifie "annoncer en retour". Renoncer oui, à condition d'annoncer quelque chose en retour. Il faut pouvoir abandonner les choses. Un sacrifice est un abandon, je dois être prêt à abandonner ma vie s'il le faut, mais à condition que cela annonce quelque chose en retour. Sinon c'est un renoncement qui serait purement négatif et inutile. » Marc Ballanfat
Renoncer à être l'auteur de ses actes : « Le deuxième niveau de renoncement consiste à renoncer à être l'auteur de ses actes. C'est un renoncement philosophique, plus exigeant que le premier car il ne s'agit pas seulement de renoncer à justifier ses actes, mais de renoncer même à en être l'auteur. C'est la nature qui est l'auteur, c'est elle qui fait que les hommes s'opposent les uns aux autres. Dans la Bhagavad-Gita il n'y a pas de libre arbitre, d'une certaine manière, d'autres ont déjà choisi pour nous. Il y a beaucoup de parallèles avec le stoïcisme. » Marc Ballanfat
Textes lus par Bernard Gabay et François Chaumette :
La Bhagavadgītā, Chant I, vers 28-31 & 45-46, éditions Garnier Flammarion, traduction et présentation par Marc Ballanfat, 2007
La Bhagavadgītā, Chant III, vers 4-8,
La Bhagavadgītā, Chant VI, vers 20-27
La Bhagavadgītā, Chant IV, vers 17-22
Sons diffusés :
Archive, récit du début du Mahâbhârata par Jean-Claude Carrière, 1998
Extrait du film Gandhi de Richard Attenborough, 1983
Extrait d'un courrier de poilus, dans Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, de Jean-Pierre Guéno, 2012
Musique de The Bobs, Slow Down Krishna
DEUXIÈME ÉPISODE : KRISHNA LIBÈRE-MOI
Dans la tradition indienne, la Bhagavadgītā fonde les sept théories de l’amour divin : quels rapports les humains entretiennent-ils avec les divinités ? Quelles sont les limites de la dévotion, que l'on appelle bhakti ? Comment se libérer de notre existence ?
La Bhagavadgītā est un texte mythologique, philosophique et poétique, aux multiples sens inépuisables, comme si l'Ancien Testament rejoignait l'Illiade et l'Odyssée d'Homère.

Ce texte raconte comment le soldat Arjuna, au milieu d'un champ de bataille, découvre que le conducteur de son char n'est autre que le dieu Krishna qui peut lui venir en aide à condition de ne faire qu'un avec lui...
L'invitée du jour : Silvia D’Intino, indianiste, philologue, chercheur au CNRS, directrice adjointe du laboratoire ANHIMA (Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques)
Textes lus par Bernard Gabay :
Bhagavadgītā, chant II, versets 18-25 et 29-30, traduit du sanskrit par Sylvain Lévi et Joseph Trumbull Stickney (restituée d'après le manuscrit original par Silvia D’Intino), éditions Allia
Bhagavadgītā, chant IX, versets 25-34, traduit du sanskrit par Sylvain Lévi et Joseph Trumbull Stickney(restituée d'après le manuscrit original par Silvia D’Intino), éditions Allia
Bhagavadgītā, chant XI, versets 15-17 et 23-25,traduit du sanskrit par Sylvain Lévi et Joseph Trumbull Stickney(restituée d'après le manuscrit original par Silvia D’Intino), éditions Allia
Sons diffusés :
Archive de Jean-Claude Carrière, 4 janvier 1984, dans l'émission Quotidien pluriel, France Inter
Chanson de Caterina Valente & Edmundo Ros, Hare Krishna
Extrait d'un documentaire du 3 décembre 2012, dans l'émission Sur les docks, France Culture
Chanson de fin : George Harrison, My sweet Lord
TROISIÈME ÉPISODE : LE YOGA, VOYAGE AU CENTRE DE SOI
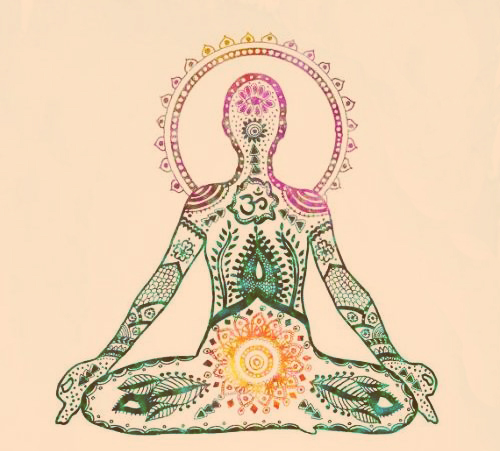 Le yoga est au cœur de la Bhagavadgītā, que l'on peut lire comme un hymne à cette voie vers la libération. Mais qu'est-ce que le yoga ? Un enseignement métaphysique, spirituel et physique ? Comment lâcher prise ?
Le yoga est au cœur de la Bhagavadgītā, que l'on peut lire comme un hymne à cette voie vers la libération. Mais qu'est-ce que le yoga ? Un enseignement métaphysique, spirituel et physique ? Comment lâcher prise ?
Parfois, les clichés ont raison et constituent d'excellents moyens d'apprivoiser l'inconnu.
Par exemple, difficile de parler de spiritualité indienne sans immédiatement imaginer un homme assis en position du lotus en train de méditer, avec, derrière lui, le dessin du dieu Krishna en train de jouer de la flûte ou de conduire un char.
Ces images sont justes, si justes, que l'un des textes incontournables et fondateurs de la pensée indienne, la Bhagavadgītā, peut être lue comme... un hymne au yoga.
L'invitée du jour : Colette Poggi, philosophe indianiste et sanskritiste
Textes lus par Bernard Gabay :
Bhagavadgītā, chant XIII, versets 2-3, 5-11, traduction d’Alain Porte, éditions Arléa
Extrait des Ennéades I, 6 [1 ; Sur le beau], de Plotin, traduction de M. N. Bouillet, IIIe siècle ap. J-C.
Bhagavadgītā, chant VI, versets 10-14, 16-18 et 20-21, traduction d’Alain Porte, éditions Arléa
Sons diffusés :
Extrait du film Trois gars, deux filles et un trésor, de John Rich, 1967
Extrait du film Mange, prie, aime, film de Ryan Murphy, 2010
Chanson de fin : Elvis Presley, Yoga is as yoga does
QUATRIÈME ÉPISODE : UNE ŒUVRE UNIVERSELLE
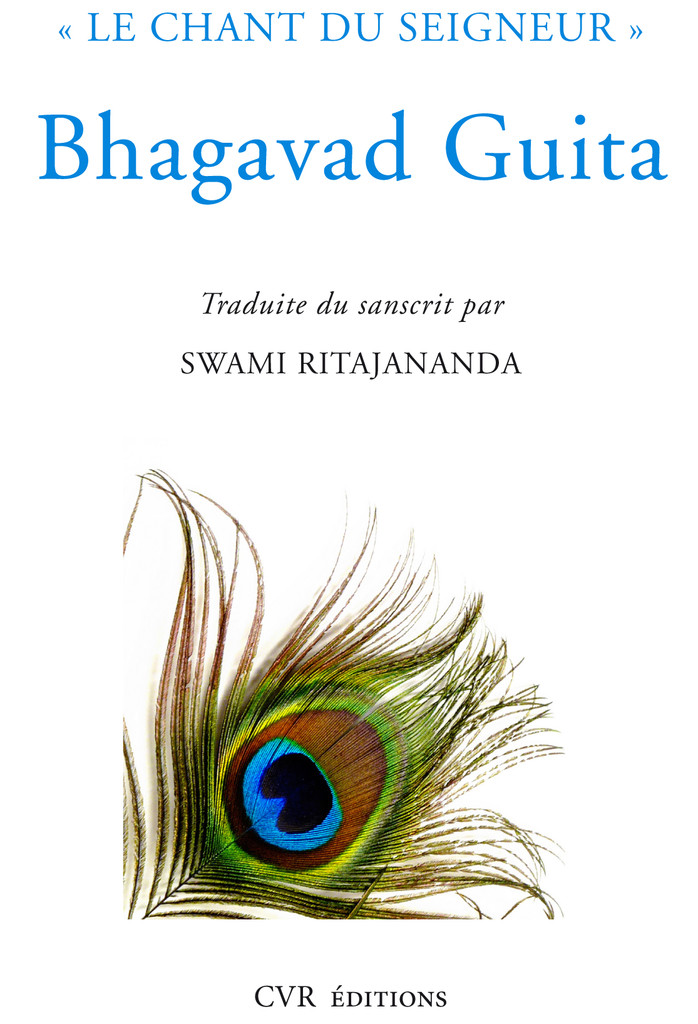 Gandhi, Einstein, Martin Luther King : nombreuses sont les personnalités ayant cité la Gītā, devenue l'oeuvre populaire la plus lue et traduite de la tradition indienne. Mais comment ses usages permirent de justifier des positions opposées, tant sur la violence, que l'égalité entre les individus ?
Gandhi, Einstein, Martin Luther King : nombreuses sont les personnalités ayant cité la Gītā, devenue l'oeuvre populaire la plus lue et traduite de la tradition indienne. Mais comment ses usages permirent de justifier des positions opposées, tant sur la violence, que l'égalité entre les individus ?
Lorsque le 16 juillet 1945, Oppenheimer, le directeur scientifique en charge de la production de la première bombe atomique, assiste au premier essai dans le désert du Nouveau Mexique, la vue de l'immense champignon atomique lui évoque immédiatement... la Bhagavadgītā, le texte indien vieux de plus de deux mille ans qui inspira également Thoreau, Mandela, et avant eux, les Romantiques allemands.
Mais qu'est-ce qui, dans ce court texte racontant l'apparition du dieu Krishna au guerrier Arjuna sur un champ de bataille, lui confère une portée universelle ?
L'invité du jour : Raphaël Voix, ethnologue, chargé de recherche au CNRS, spécialiste de l'ascétisme hindou.
Texte lu par Bernard Gabay :
Discours de Swami Vivekananda, Parlement mondial des religions Chicago, 11 septembre 1893
Sons diffuses :
Archive de J. Robert Oppenheimer, The Decision to Drop the Bomb, NBC, 1965
Chanson de John Lennon, God
Adèle van Reeth lit un extrait d'un texte de Gandhi découvrant la Bhagavadgītā
Archive de Swami Prabhupāda présentant la Bhagavadgītā
Gaur Gopal Das explique la Bhagavadgītā en la comparant au film animé Le Rion Lion, de Disney : Bhagavadgita Explained in 10 Minutes, TRS Clips
Chanson de fin : Jimi Hendrix, Bold as Love



